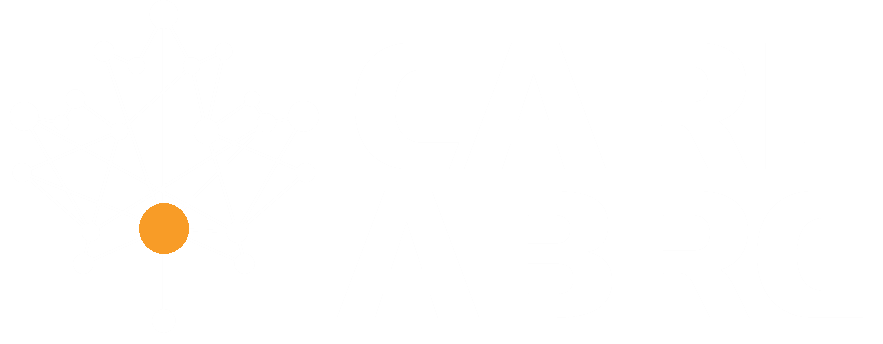Voici des extraits d’entrevues menées auprès de membres de la direction de bibliothèques universitaires canadiennes au sujet de leurs expériences en vue de l’adoption de politiques de libre accès au sein de leur établissement.
Personnes interviewées :
- Université Concordia : Guylaine Beaudry, University Librarian
- Simon Fraser University : Gwen Bird, Dean of Library Services
- Université de Montréal : Richard Dumont, ancien Directeur général, Direction générale, and Diane Sauvé, Directrice, Direction du soutien à la réussite, à la recherche et à l’enseignement
- York University : Joy Kirchner, Dean of Libraries
Quelles valeurs ou caractéristiques institutionnelles notables avez-vous dû prendre en compte avant d’entamer une discussion sur le libre accès sur votre campus?
G. Beaudry (Concordia) : Ce qui s’est passé à Concordia, c’est que nous nous préparions pour le Congrès de Concordia en 2010; Ronald Rudin, du Département d’histoire, a présenté l’idée d’adopter une résolution sur le libre accès, afin de laisser un héritage durable du Congrès. Je peux certainement dire que le libre accès est quelque chose dont nous avons souvent discuté à Concordia, cela fait même partie de notre ADN, et c’était une progression naturelle d’envisager un tel projet et d’avoir quelque chose de durable après le Congrès.
G. Bird (SFU) : La SFU a commencé à travailler sur la politique de libre accès en 2015. Cela a été facilité par la mise en œuvre de notre plan stratégique pour les bibliothèques dans lequel nous avons identifié les valeurs fondamentales pour les bibliothèques. « L’ouverture » était l’une des valeurs fondamentales identifiées tout au long du plan et se retrouve dans tout le document. Cela faisait partie de la direction des bibliothèques de SFU depuis de nombreuses années. De plus, en tant qu’établissement engagé dans la communauté, il est important de ne pas verrouiller la recherche. Il a été facile d’identifier les valeurs de l’établissement et de la bibliothèque lors de la rédaction de la politique.
R. Dumont et D. Sauvé (UdeM) : Le libre accès correspond parfaitement aux visées institutionnelles. De fait, l’UdeM croit que « les avancées de la connaissance, au sein comme au carrefour des disciplines constituées, sont porteuses de progrès sociaux et garantes d’une société démocratique, au service des citoyens ». Elle croit aussi que « le partage et la transmission du savoir sont essentiels à une plus juste compréhension du monde dans lequel nous vivons ». Enfin, « l’UdeM croit au pouvoir des actions menées au service du bien commun et considère l’amélioration générale de la société comme la finalité première de l’enseignement et de la recherche ».
J. Kirchner (York) : J’ai remarqué qu’il y avait de très bonnes activités de communication savante et un engagement pour le libre accès sur le campus, mais que cela se produisait de façon ponctuelle. Je trouvais qu’une approche coordonnée était nécessaire pour faire susciter une discussion auprès de toute la communauté universitaire sur des questions aussi importantes que les communications savantes et leur publication, à savoir le soutien à la recherche ouverte, les besoins propres aux nouveaux modes de diffusion de la recherche, le dysfonctionnement du modèle économique actuel pour les publications savantes, le soutien pour la gestion des données et ainsi de suite. Je savais également que nous n’avions pas de mécanisme pour aider notre corps professoral relativement aux nouveaux mandats de financement en libre accès et en matière de gestion des données des trois organismes subventionnaires. J’ai noté que, bien que notre bibliothèque avait une expertise reconnue dans les communications savantes, comme en témoigne notre gestion de 46 revues en libre accès, deux dépôts en libre accès robustes, une politique de libre accès approuvée pour les bibliothèques de l’Université York et d’importants travaux de recherche et d’activités de la part de personnes impliquées dans ce domaine, nous n’avions aucune structure pour répondre pleinement aux besoins et aux activités de libre accès du campus. J’ai également été informée qu’il y avait eu une tentative antérieure avec des bibliothécaires et un membre du corps professoral pour inciter le campus à lancer une politique de libre accès qui n’avait pas réussi.
Quelle a été l’impulsion pour une telle politique? Quelles mesures ont été prises pour faire adopter une politique de libre accès sur votre campus? Quelle était la première chose qui devait arriver?
G. Beaudry (Concordia) : La première chose qui arriva fut d’avoir une conversation sur le campus; différents moyens ont été pris, Gerald Beasley [bibliothécaire en chef à l’époque] s’est rendu à de très nombreuses réunions départementales pour parler du libre accès. Nous avons lancé notre dépôt institutionnel pendant cette période, Spectrum, de sorte qu’il y avait donc un mécanisme physique pour accueillir les publications. Des conversations individuelles, des assemblées publiques, des assemblées départementales, des réunions avec d’autres comités notamment pour les priorités et la planification; il y a eu deux séances au Sénat et quelques allers-retours sur le libellé. Tout était surtout axé sur la résolution et non sur le processus. Obtenir la résolution avant le Congrès et préparer le dépôt institutionnel pour l’entrée en vigueur de la politique.
G. Bird (SFU) : Ce n’était pas la première fois que nous envisagions une politique de libre accès. SFU a un fonds de libre accès établi qui a contribué à sensibiliser le public au libre accès; les professeurs et les étudiants savaient qu’ils pouvaient venir nous voir parce que nous administrons ce fonds. Nous sommes également l’institution hôte du Public Knowledge Project (PKP). Toutes ces activités nous disaient que la politique sur le libre accès avait l’appui nécessaire. Nous avons également participé au sondage ITHAKA Research de l’ABRC, où nous avons pris conscience que le soutien au libre accès des professeurs de la SFU était le plus élevé parmi toutes les bibliothèques de l’ABRC (Association canadienne des bibliothèques de recherche); nous savions donc qu’il y avait un grand soutien.
R. Dumont et D. Sauvé (UdeM) : S’il n’y a pas encore en 2018 de politique de libre accès à l’Université de Montréal, des travaux ont démarré à ce sujet en 2015 et sont toujours en cours. C’est en effet en 2015 qu’à la recommandation du Comité consultatif des bibliothèques, un groupe de travail mixte relevant à la fois du Comité de la recherche de l’UdeM et du Comité consultatif des bibliothèques a été mis sur pied avec à sa présidence deux chercheurs. […] Cependant, en toile de fond de la création du groupe de travail mixte mentionné, on trouve la hausse faramineuse du coût des périodiques savants, et le modèle d’affaires des éditeurs commerciaux qui emprisonne les bibliothèques dans un « tout ou rien » en les obligeant à s’abonner à de grands ensembles. Ces facteurs étaient présents depuis un certain nombre d’années, mais ils ont frappé plus durement l’UdeM à partir de 2014. Des actions et une mobilisation de la communauté universitaire ont donc débuté sur ce front qui a tout à voir avec les objectifs du libre accès, soit la meilleure accessibilité possible aux résultats de la recherche.
J. Kirchner (York) : Avec la création d’un comité directeur sur le libre accès et les données ouvertes à l’échelle institutionnelle, coprésidé par le doyen des bibliothèques et le vice-doyen de la recherche et de l’innovation, nous avons décidé que, comme une politique de gestion des données était nécessaire, nous nous lancerions dans la rédaction d’une politique conjointe de libre accès et de données ouvertes puisque les deux questions étaient étroitement liées. Il est devenu clair avec quelques discussions initiales sur le campus qu’avant de pouvoir discuter des données ouvertes et de la gestion des données, la communauté devait d’abord être mieux informée sur le libre accès. À cette fin, il a été décidé de créer un sous-comité des politiques de libre accès et un sous-comité de la gestion des données. […] La politique de libre accès a été élaborée et créée au sein du sous-comité et soumise au comité directeur pour approbation. Avec le comité directeur, un plan de formation institutionnel a été mis en place et toute la documentation à l’appui, y compris une FAQ, du matériel de présentation et des plans pour prendre la parole à toutes les réunions facultaires et aux réunions des vice-doyens de la recherche. Nous avons également organisé plusieurs séances publiques. L’objectif était de passer par un processus visant à soumettre la politique au Sénat pour discussion et approbation d’ici la fin de l’année.
Selon vous, quelle était la meilleure raison pour laquelle l’université devrait investir temps et énergie à cette discussion?
G. Beaudry (Concordia) : Profiter de l’occasion aborder de ce sujet avec la communauté et avoir une conversation. Après près de dix ans, au moins la moitié des professeurs avaient une opinion sur le libre accès; faire du libre accès un sujet de discussion était la meilleure raison.
R. Dumont et D. Sauvé (UdeM) : Toutes les raisons mises de l’avant par le mouvement pour le libre accès sont bonnes pour mettre en place des mesures et stratégies de publication en libre accès! De celles plus altruistes d’une meilleure accessibilité par tous aux résultats de la recherche, à celles plus “égoïstes” d’un rayonnement accru de nos chercheurs, en passant par une meilleure utilisation des fonds publics qui nous sont confiés pour mener à bien la mission universitaire.
J. Kirchner (York) : Cela nous a donné l’élan et l’occasion d’avoir une discussion franche sur le libre accès et des sujets connexes comme le droit d’auteur, les publications et les dépôts institutionnels. La discussion a également permis à la bibliothèque de revoir ses modèles de soutien dans le cadre de sa restructuration tout en dégageant quels étaient les besoins de la communauté. Cela a également été bénéfique en donnant aux bibliothèques une visibilité accrue par rapport à nos connaissances et notre expertise à ce sujet.
Qu’avez-vous retenu de plus important? Quels ont été les défis, les points de friction ou les perceptions les plus importants à relever et comment avez-vous réussi à les surmonter?
G. Beaudry (Concordia) : Nous avons besoin d’un processus pour télécharger les documents pour les professeurs, comment ajouter les métadonnées, parce que les professeurs n’ont pas le temps et ne le font pas si souvent. S’ils ne le font que trois ou quatre fois par an, ils ne savent pas comment. Je pense que nous ne les servons pas bien à cet égard, parce que nous parlons de libre accès, mais les outils ne fonctionnent pas très bien. C’est un peu une sorte d’énigme. Facile à dire 10 ans plus tard.
G. Bird (SFU) : L’Association des professeurs avait de sérieuses préoccupations au sujet d’une politique stricte de retrait. Ils se demandaient comment la politique pourrait être appliquée. Leurs préoccupations ont finalement mené à des changements de formulation et à un compromis. Il était important que nous transmettions la politique au Sénat avec le soutien de l’Association des professeurs, et non en dépit de leur rejet. Ainsi, après mûre réflexion, le comité est convenu de transiger sur une politique plus nuancée afin de répondre à leurs préoccupations.
Lorsque la politique a été transmise au Sénat, nous avons reçu une autre objection que nous n’avions pas attendue d’un représentant du personnel qui demandait pourquoi le personnel n’était pas mentionné dans la politique. (Le Sénat n’a pas compétence sur le personnel, de sorte que la politique ne comprend pas le personnel.) La version a été approuvée au Sénat en reconnaissant en note de bas de page dans la politique que le personnel était invité à contribuer.
R. Dumont et D. Sauvé (UdeM) : Il y a une expression qui dit qu’on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu’elle pousse. Le dossier du libre accès en est un qui exige temps et patience, mais plus de 15 ans après la Déclaration de Budapest, on sent que beaucoup de chemin a été accompli en ce qui a trait à la compréhension des enjeux et à l’adhésion aux finalités du libre accès.
Parmi les défis, mentionnons la sensibilité des chercheurs – à juste titre – à tout ce qui pourrait ressembler à un ajout de tâches administratives qui viendrait gruger du précieux temps de recherche… Il faut donc s’assurer de prévoir mettre en place des modalités de dépôt en libre accès qui soient simples et efficaces, et de bien rassurer la communauté à ce sujet lorsqu’on présente la possibilité d’introduire une politique de libre accès.
J. Kirchner (York) : Au début, j’étais très inquiète de la perte d’élan en raison d’un conflit de travail. Cependant, j’ai convaincu le comité que nous devions tout de même continuer. Cela a aidé les membres du comité directeur à apprécier le travail du comité et la discussion globale que le travail a engendrée. Les membres étaient désireux de continuer. J’ai également appris que chaque établissement a son propre contexte, sa propre culture et sa propre perspective. Certains éléments fonctionnaient bien dans d’autres endroits où j’ai travaillé, mais ils ne fonctionnaient pas à York. Par exemple, montrer le modèle de libre accès de Harvard ou des exemples d’autres institutions non canadiennes n’a pas bien marché à York : on voulait des exemples canadiens.
Quelle a été la plus grande surprise?
G. Beaudry (Concordia) : La discussion a été bonne, il y avait des défenseurs très forts, et c’était une bonne discussion et un bon débat. Avant la réunion du Sénat, nous avions estimé que nous avions au moins 66 %, et cela a été adopté à l’unanimité.
G. Bird (SFU) : Je n’aurais probablement pas dû être surprise que l’Association des professeurs allait être notre plus grande négociation et qu’elle allait s’opposer à une politique formulée de manière stricte.
J. Kirchner (York) : Nous avons appris assez tard dans le processus qu’il y avait un modèle de politique du Sénat spécifique que nous devions appliquer. Cela a changé la construction de ce qui était compris dans la politique d’origine et certains autres éléments spécifiques devaient être inclus pour respecter les exigences d’une politique officielle. Par exemple, une personne spécifique devait être nommée et était redevable de la politique. Dans les versions antérieures, nous avions simplement indiqué un représentant du vice-recteur. Or, avec cette exigence du modèle de la politique, nous avons décidé que le doyen des bibliothèques serait responsable de la politique, en consultation avec le vice-recteur et le vice-président à la recherche, au besoin.